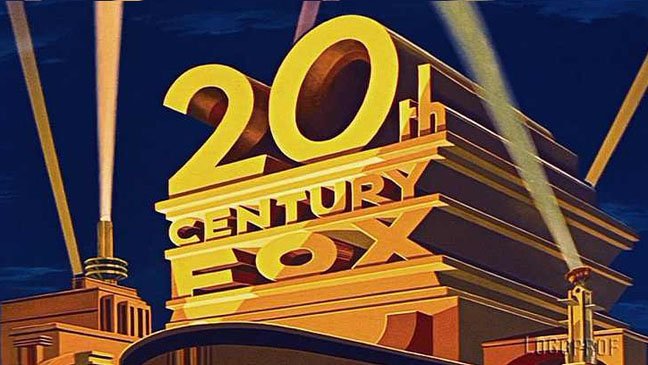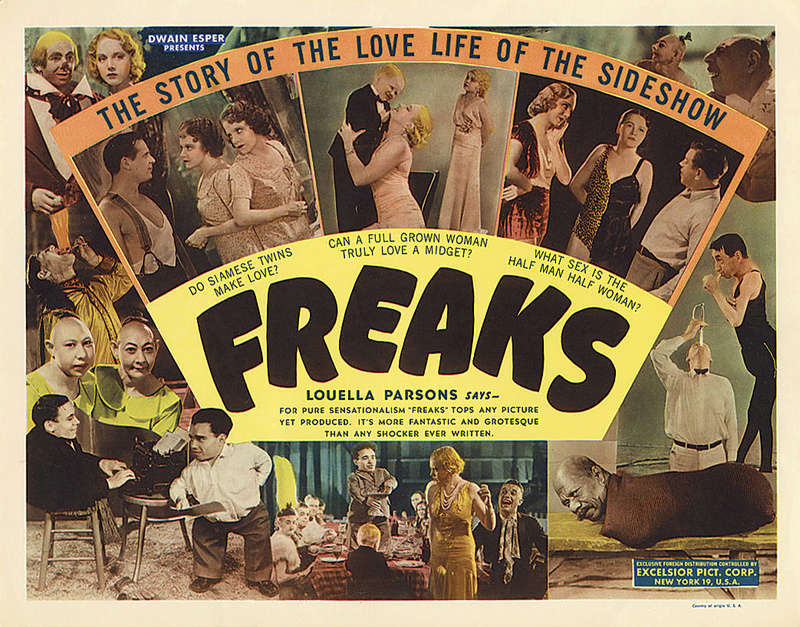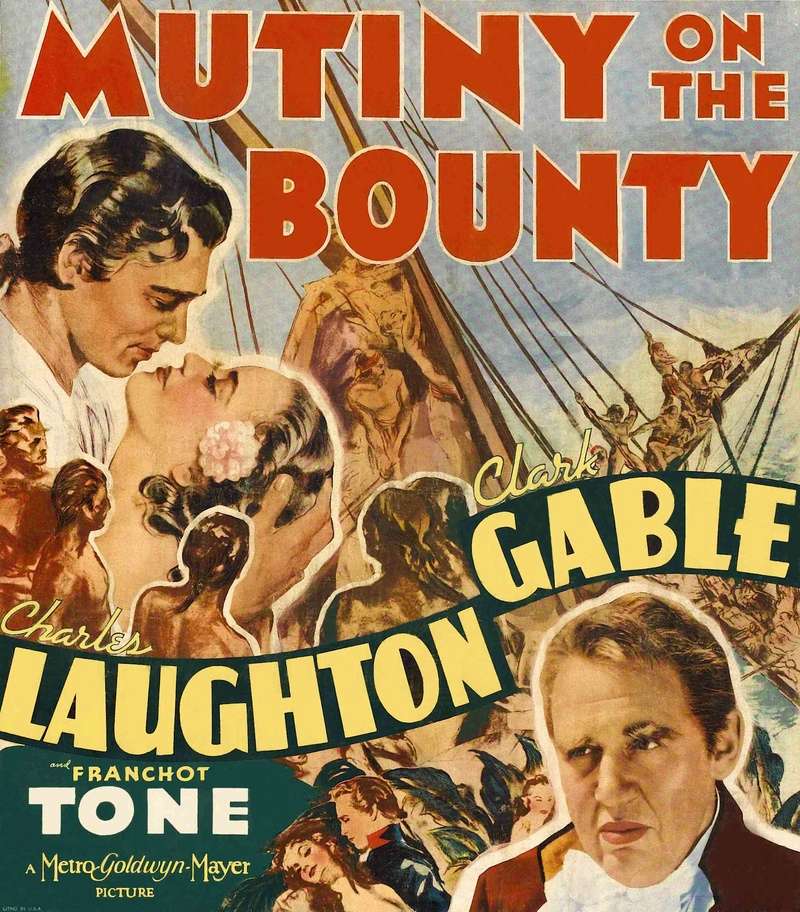M le Maudit
Fritz Lang; 1931
Fritz Lang; 1931
La réputation de Fritz Lang, au moment où sort son premier film parlant, n'est déjà plus à faire, et ce depuis longtemps. Son style, mélangeant habilement baroque, futurisme et expressionnisme, lui a permis de réaliser de grandes fresques fantastiques comme Les Nibelungen, directement inspiré par la fameuse « Tétralogie » de Wagner (L'Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des Dieux), ou le beaucoup plus venimeux Docteur Mabuse mettant en scène un manipulateur hypnotiseur réduisant en esclavage ceux qui le côtoient avant d'être lui-même pris au piège de ses ambitions qui le conduiront à sa chute. Dans la même veine, il réalise en 1927 l'inquiétant Metropolis : film de science-fiction hautement métaphorique de la lutte des classes où il fait part d'une inquiétude non-dissimulée vis à vis de l'évolution technologique de l'industrie...tout en reprenant l'esthétique du mouvement qu'il dénonce indirectement : le futurisme.
Ces films ont plusieurs points communs : l'expressionnisme, d'une part, y est omniprésent tant dans les images que dans le message distillé et il faudra beaucoup de temps au réalisateur pour en sortir définitivement (peut-être précisément parce qu'il en a toujours minimisé l'impact). D'autre part ils sont extrêmement « précis » dans les cadrages, le jeu des acteurs, la longueur (souvent importante)... Précis...pour ne pas dire « rigides »...
Fritz Lang n'a pas, en-effet, le génie pur et insolent d'un Murnau, d'un Griffith ou d'un Eisenstein : il est plus « formel », plus attentif aux petits détails (du moins de façon plus visible), moins instinctif aussi... Ça a aussi ses avantages : ses films ne sont jamais « bâclés », ne prennent pas le public à contre-pied et tiennent toujours leurs promesses. De plus, son grand professionnalisme rassure les décideurs qui savent qu'il ne se lancera jamais dans une quelconque aventure à la légère (ça persistera tout au long de sa carrière : Fritz Lang fait partie de ces réalisateurs rares qui ne déçoivent jamais quand on regarde un de leurs films...). Aussi, lorsqu'on apprend qu'il est en train de réaliser un film parlant, les sourcils se lèvent et les oreilles se tendent : un tel type a certainement autre-chose en tête que plaquer des mots interchangeables sur des images banales !.. Qui sait ? ça va peut-être donner le chef d'œuvre qu'on attend maintenant depuis cinq ans...
La première idée géniale de M le Maudit est certainement son scénario : un tueur en série pédophile sévit dans une grande ville d'Allemagne et nargue la police. Ce criminel, joué par un étourdissant Peter Lorre, apparaît pourtant progressivement aussi victime que bourreau, prisonnier de ses obsessions et incapable de maîtriser ses pulsions... La police se casse les dents, cherche des indices partout, la psychose s'installe dans la population qui voit le coupable à chaque coin de rue, tout le monde soupçonne tout le monde...mais les plus furieux sont les bandits, mendiants, prostituées et autres marginaux qui, avec les contrôles incessants, ne peuvent plus rien faire et qui décident de se lancer eux aussi sur les traces de ce tueur...
Ce scénario va permettre à Fritz Lang d'utiliser le parlant pour en faire un véritable élément dramatique sans pour autant négliger le côté purement visuel de son film, visuel qui se manifeste par ces montages implacables en plans souvent fixes pour marquer en premier lieu la disparition de la fillette victime de M (l'horloge, la chaise vide, le ballon abandonné...), puis pour illustrer les plans, interrogations...et parfois mensonges des policiers (particulièrement dans la scène où ils font croire au voleur pris sur le fait qu'un gardien a été tué...alors qu'on voit ce même gardien se régaler au même moment d'un imposant verre de bière). L'image marque aussi les rapports de force en exagérant volontairement la plongée ou la contre-plongée pour les symboliser de façon très « visible ». Mais c'est certainement la façon de montrer M qui rend ce film visuellement inoubliable : outre la marque laissée sur lui par les mendiants afin que les bandits puissent l'identifier, il est, au fil du film, de plus en plus « désigné » par le décor qui soit le pointe soit l'encadre, mais qui ne lui laisse aucun échappatoire. Ce côté pathétique est contrebalancé par ses apparitions aux moments où ses pulsions le transforment en prédateur, apparitions où il semble se fondre dans l'ombre...en sifflant une fameuse mélodie de Grieg...
Car c'est cette mélodie qui reste le plus dans nos mémoires une fois qu'on a vu M le Maudit : tiré du quatrième mouvement de Peer Gynt (« Dans l'antre du roi de la montagne »), cet air obsédant et effrayant a pour nous l'effet d'un signal de danger imminent, de basculement dans la folie... Mais ce n'est que le son le plus marquant du film, certainement pas le seul !.. Se passant de tout bruitage superflu, Fritz Lang marque ainsi parfaitement les contrastes entre le calme parfois oppressant et les moments de bruits stridents qui agressent vraiment l'oreille, dont la foule paniquée...ou les accusations finales du procès improvisé par les bandits où l'ire de la masse semble presque plus folle et plus criminelle que le tueur hurlant son impuissance tandis que son avocat essaie de placer chacun face à ses responsabilités...et de démontrer qu'on ne peut juger un homme atteint d'une maladie mentale !.. Ce courage moral impressionnant place clairement Lang en porte à faux vis à vis du Parti Nazi, de plus en plus populaire dans l'Allemagne de cette époque (il ne tardera pas à s'exiler en Amérique pour fuir les représailles).
Pour en revenir sur le son, remarquons qu'il sert aussi à un pan très original et particulièrement attachant du film : son humour très fin et très subtil qui l'allège très salutairement. Parmi les séquences de ce type, une porte directement sur l'ouïe : la logeuse dure d'oreille de M qui exaspère les policiers tant par sa surdité que par certains excès de zèle qui perturbent leur travail. Un autre moment mémorable est la recherche nocturne de M par les bandits dans des bureaux déserts, toute de légèreté mais remarquable de suspense...et qui se termine presque en gag avec la capture du cambrioleur plein d'humour et sympathique Franz, impeccablement joué par Freidrich Gnass...
Le seul défaut qu'on pourrait trouver à ce film est, précisément, cette rigidité propre au style de Lang qui l'a assez mal fait supporter l'épreuve du temps. Une autre déception vient de sa fin, totalement « expédiée » par un montage ultra-rapide qui laisse dans l'expectative sans pour autant choisir délibérément de rester suspensif... Cette réserve mise à part, M le Maudit demeure un modèle de film qui a atteint son objectif : légitimer le parlant au cinéma, ce qui va nous permettre de laisser derrière nous ce premier continent pour voguer sereinement vers le deuxième, le plus imposant et le plus important de ce monde à-travers mes yeux : celui de l'âge d'or de cet art...